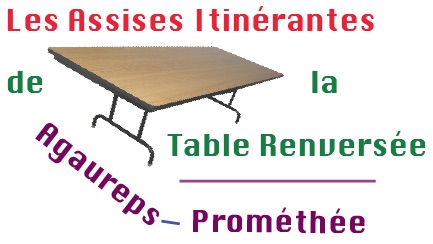Sommaire du numéro 168 : Spécial « Géopolitique »
- Edito de Francis DASPE « La question d’Orient renouvelée loin des yeux de l’Occident ? » page 2
- Texte de Francis DASPE : « Le démembrement de l’homme malade de l’Europe » page 3
- Texte d’Agathe RAIENO : « Terminer un conflit militaire : la première guerre mondiale » page 12
- Le vertige des chiffres… » par Thierry DONGUAT: « La Corée du Sud illibérale ? » page 15
- Fiche d’adhésion (facultative mais conseillée…) pour 2024 page 17
La question d’Orient renouvelée loin des yeux de l’Occident ?
Le soleil se lève à l’Est, c’est une certitude. Une grande lueur a pu venir de l’Est, c’est une conviction qui peut ne pas être partagée. Aux XIX° et XX° siècles, ce qui était appelée « la question d’Orient » a fortement influencé les orientations géopolitiques de la planète, contribuant à façonner les enjeux du monde contemporain.
Cette Lettre du mois de l’AGAUREPS-Prométhée, nouveau numéro spécial consacré à la géopolitique, remet sur le devant de la scène la question d’Orient. Cela est fait par l’intermédiaire d’un long texte revenant sur un événement trop souvent minoré, la désagrégation de l’empire ottoman à la fin de la première guerre mondiale. Ce fut en effet un événement géopolitique considérable, dont il n’a pas toujours été pris la mesure comme il aurait fallu. Les incidences sur un nombre élevé des conflits les plus actuels ne sont pas anodines. Elles participent à offrir une grille de lecture et d’analyse possédant quelque pertinence à la situation géopolitique du moment présent.
Un autre texte examine quelques uns des aspects caractérisant les conditions de la fin de la première guerre mondiale. Il donne incontestablement matière à réfléchir, mettant en exergue quelques aspects apparemment bien connus. Mais ceux-ci ne sont pas pour autant dénués d’approximations malvenues ou de lieux communs confinant à l’occasion au contresens. Les deux participent pareillement à entretenir une compréhension obscurcie de la réalité, d’autant plus que d’autres faits franchement méconnus ou oubliés exigent d’utiles précisions rectificatives.
Enfin, un dernier article de la rubrique « Le vertige des chiffres » porte sur la Corée du Sud. Il est réalisé à partir d’un article paru dans Le Monde Diplomatique. Il permet un décryptage édifiant d’une autre réalité, confinant à l’illibéralisme, mais masquée en raison des enjeux liés à l’affrontement idéologique de la guerre froide. Edifiant, car la réalité dramatique et indéfendable de la situation en Corée du Nord ne peut s’exonérer à moindres frais de se pencher sur d’autres, indiscutablement dérangeantes, du voisin du Sud.
On assiste bien à un renouvellement de la question d’Orient, et pas seulement en raison du déclenchement de deux guerres dans ces contrées, en Ukraine et à Gaza. Ce qui s’y passe est véritablement stratégique. Pourtant, l’Occident dominant semble ne pas en prendre toute la mesure, du moins dans sa complexité excluant toute vision manichéenne, et par delà le « deux poids deux mesures » qui lui est souvent reproché. Ces failles et ces insuffisances fournissent des arguments à la remise en cause de l’hégémonie de l’Occident exprimée par ce que l’on appelle désormais le Sud global.
Les enjeux géopolitiques sont bien évidemment structurants. C’est pour cela qu’il s’agit d’un des fils rouges de la réflexion de l’AGAUREPS-Prométhée. Aux oppositions classiques du XX° siècle, une première entre l’Est et l’Ouest, une deuxième entre le Nord et le Sud, le XXI° siècle laisse émerger de nouvelles lignes de fractures issues pour partie du télescopage des anciennes oppositions jamais soldées et de leurs inextricables interpénétrations. Parfois dans un inquiétant déni de réalité de l’Occident.
Francis DASPE
28 / 02 / 2024
Le démembrement de « l’homme malade de l’Europe »
Durant le XIX° siècle, l’Empire ottoman est couramment appelé « l’homme malade de l’Europe ». La formule, dont la paternité est attribuée en 1853 au tsar Alexandre III, a été régulièrement reprise par la diplomatie européenne pour caractériser l’inexorable déclin de cet immense empire multiséculaire. Son démembrement progressif a constitué un fait géopolitique considérable trop souvent sous-estimé, quand il n’était pas grossièrement occulté. Pourtant, sa prise en compte permet d’accéder en maintes occasions à une meilleure compréhension de réalités géopolitiques actuelles. Ses conséquences ont en effet été formidablement « impactantes », comme nous disons aujourd’hui.
Naissance et apogée
Les Turcs Seldjoukides apparurent au XI° siècle en Anatolie. Deux siècles plus tard, une branche obtint son autonomie, celle des Ottomans, qui commença à conquérir des territoires aussi bien en Asie qu’en Europe dans les Balkans, encerclant de la sorte l’empire byzantin, continuateur de l’empire romain d’Orient. Tant et si bien, qu’en 1453, Constantinople tomba finalement aux mains des Turcs ottomans, pour prendre le nom d’Istanbul seulement en 1930, à l’époque de la république kémaliste.
Ce fut le signal d’un siècle de nouvelles conquêtes, tant en Asie qu’en Afrique ou qu’en Europe, aussi bien continentales que maritimes. Le règne de Soliman le Magnifique de 1520 à 1566 est considéré comme l’apogée de l’empire ottoman. Ce dernier s’inséra dans le jeu diplomatique de l’Europe chrétienne dès le XVI° siècle. En effet, la France, pour desserrer la prise en tenaille par les Habsbourg d’Espagne et d’Autriche, fit le choix d’une « alliance de revers », jugée scandaleuse et contre-nature, avec le « Grand Turc ». La France bénéficia de surcroit d’avantages économiques, commerciaux, fiscaux, religieux et judiciaires dans le cadre de la signature en 1536 entre François I° et Soliman le Magnifique des Capitulations. Constamment renouvelées, elles restèrent en vigueur jusqu’au début du XX° siècle.
Déclin inexorable
Dès la fin du règne de Soliman, l’empire ottoman entre dans une période laissant augurer le début d’un lent déclin. Celui-ci se matérialise par quelques défaites militaires significatives qui constituent autant de coups d’arrêts brutaux : la bataille maritime de Lépante en 1571, l’échec aux portes de Vienne en 1683. L’élan ottoman est durablement brisé. Le cycle des guerres austro-turques va être prolongé par un nouveau cycle de conflits russo-turcs, avec notamment pour enjeux l’accès aux mers chaudes et la protection des chrétiens orthodoxes.
A cet inexorable reflux devant l’Autriche et la Russie, il faut ajouter un affaissement dans l’organisation administrative, l’autorité politique des sultans, la puissance militaire et le contrôle des vastes territoires conquis. S’ouvre de la sorte la « question d’Orient » qui va devenir omniprésente tout au long du XIX° siècle. L’empire ottoman devient ainsi véritablement « l’homme malade de l’Europe ».
L’immense empire ottoman qui couvrait à la fin du XVIII° siècle environ 3 millions de km2 et rassemblait 20 à 30 millions d’habitants va se réduire peu à peu comme peau de chagrin. C’est la conséquence d’une série de mouvement autonomistes (en Égypte, en Serbie, en Moldavie) ou indépendantistes (en Grèce, en Crète), de pertes territoriales comme Aden ou Alger du fait de la pression coloniale européenne (respectivement anglaise et française). Il devient surtout le jouet des intérêts des puissances européennes, Angleterre, France, Russie ou Autriche principalement. Si la guerre de Crimée de 1854 à 1856 semble lui donner un répit, avec le traité de Paris du 30 mars 1856 garantissant son intégrité territoriale, cela n’est dû qu’au soutien des Français et des Anglais qui préfèrent le maintenir en vie sous perfusion, au contraire des Russes qui visaient à son démantèlement le plus rapide.
La Russie prend partiellement sa revanche lors de la nouvelle guerre russo-turque de 1877-1878 qui poursuit son dépècement. Par le traité de Berlin de 1878, la Serbie et le Monténégro obtiennent leur indépendance : l’empire a encore perdu 210 000 km2 et 20 % de sa population. Avec la perte progressive des provinces balkaniques, l’empire se resserre sur l’Asie et l’Anatolie. Il s’islamise également.
L’empire ottoman en 1914
A la veille de la première guerre mondiale, l’empire ottoman se déploie sur un territoire immense, mais ne rayonnant plus que sur deux continents. Il a en effet perdu ses dernières possessions africaines en 1912 avec la conquête et la colonisation de la Libye par l’Italie. C’est surtout un empire qui s’effondre inexorablement.
Il connaît d’abord une profonde crise politique. L’instabilité règne, avec de nombreux soubresauts politiques illustrés par des révolutions de palais, des coups d’état et autres revendications ou rébellions des Jeunes-Turcs. En décembre 1876, une constitution avait été imposée au sultan. Elle ne fut respectée pas plus de deux mois.Une nouvelle révolution le 24 juillet 1908 oblige le sultan Abdulhamid à restaurer la constitution de 1876 et à convoquer des élections remportées par le CUP (Comité Union et Progrès), c’est-à-dire par les Jeunes-Turcs. En 1909, après une traditionnelle tentative de restauration par le sultan, celui-ci est alors interné par les insurgés, et remplacé par son frère Mehmet. Ce dernier est privé de pouvoir réel, ce qui marque la fin de la monarchie absolue ottomane. Le coup d’état ottoman du 23 janvier 1913, avec l’envahissement du palais impérial, porta au pouvoir les « trois Pachas ». Cette expression désigne les membres du triumvirat qui a dirigé, après s’être fait octroyer les pleins pouvoirs, l’Empire ottoman de 1913 à la fin de la première guerre mondiale. Ils vont militer pour l’entrée du pays dans la guerre.
C’est aussi un empire humilié et vaincu lors des deux guerres balkaniques ayant précédé le déclenchement du premier conflit mondial. Avant même, l’Empire ottoman continuait à s’effondrer dans les Balkans, avec l’annexion en 1908 par l’Autriche-Hongrie de la Bosnie-Herzégovine. C’était aussi le cas ailleurs, avec la Libye (les provinces de Tripolitaine, de Cyrénaïque et du Fezzan) et l’île de Rhodes annexées par l’Italie en 1912. Des rébellions avaient lieu en Albanie, qui proclamait son indépendance en 1912. Enfin, la Bulgarie se déclarait indépendante, et la Crète se rattachait à la Grèce.
La première guerre balkanique, entre octobre 1912 et mai 1913, opposa la Ligue balkanique (Serbie, Bulgarie, Grèce et Monténégro) à l’Empire ottoman. Les armées des états des Balkans en supériorité numérique furent rapidement victorieuses. Les états de la Ligue balkanique se partagèrent la quasi-totalité des anciens territoires européens de l’Empire ottoman.
Mais en Macédoine, la Bulgarie, s’estimant lésée par ce partage, provoqua la deuxième guerre balkanique. Celle-ci opposait les Bulgares à leurs anciens alliés serbes et grecs qui firent appel à la Roumanie, du 16 juin au 18 juillet 1913. Au cours de celle-ci, l’empire ottoman récupéra sur la Bulgarie une partie des territoires en Thrace orientale perdus précédemment.
L’empire ottoman dans la 1° guerre mondiale
L’empire ottoman était devenu une variable d’ajustement dans les jeux d’alliance de l’Europe, dominés par une double préoccupation souvent contradictoire, la montée des impérialismes (qu’ils soient continentaux, maritimes ou coloniaux) et la recherche de l’équilibre des puissances. L’entrée en guerre de l’empire ottoman se fit aux côtés des Empires centraux, sous la pression des Jeunes-Turcs. Des rapports privilégiés avec l’Allemagne s’étaient noués dès la fin du XIX° siècle. Le rapprochement avec l’Autriche-Hongrie constituait un renversement d’alliance à rebours des relations conflictuelles au cours des siècles précédents. Mais ces renversements d’alliance surprenants étaient monnaie courante à l’époque. Qui aurait pu penser un siècle plus tôt qu’en 1914 la Grande-Bretagne et la Russie puissent devenir les alliées de la France ?
L’attaque des ports russes dans la mer Noire par des navires de guerre allemands avec la complicité des autorités ottomanes conduisit l’empire ottoman dans la guerre le 29 octobre 1914. Alternèrent des succès (défaite du corps expéditionnaires allié dans les Dardanelles et avancée turque jusqu’aux abords du canal de Suez en 1915) et des échecs (défaites au Caucase et en Arménie devant les armées russes, prise de Bagdad et contrôle de la Syrie en 1917 et 1918 par les Anglais). Ce sont d’ailleurs les échecs en Arménie qui enclenchèrent le génocide par la déportation et le massacre des Arméniens, accusés de pactiser avec l’ennemi russe. En fin de compte, l’empire ottoman dut se retirer de la guerre en signant l’armistice de Moudros le 30 octobre 1918. Les chefs du gouvernement Jeune-Turc s’enfuirent pour la plupart en Allemagne.
Les Accords Sykes-Picot
Le Proche-Orient arabe constitue pour les Alliés (la Triple Entente : France, Royaume-Uni, Russie) un enjeu de premier plan au cours de la première guerre mondiale. C’est un moyen d’affaiblir un allié du bloc germanique (Allemagne, Autriche-Hongrie). Ils vont s’échiner à déstabiliser l’empire ottoman, de diverses manières. Les accords Sikes / Picot en seront une parmi d’autres.
L’accord Sikes / Picot est un accord secret signé le 16 mai 1916 entre la France et la Grande-Bretagne. Il prévoit le découpage à la fin de la guerre en plusieurs zones d’influence du Proche-Orient arabe, c’est-à-dire de l’espace compris entre la mer Noire, la mer Méditerranée, la mer Rouge, l’océan Indien et la mer Caspienne, alors partie intégrante de l’Empire ottoman. Cela revenait en fait à procéder à son dépeçage en bonne et due forme.
Il fut rendu public par le gouvernement soviétique après la révolution de 1917 et suscita l’indignation du monde arabe. En effet, il illustrait la duplicité des Alliés qui promettaient en même temps l’indépendance complète aux Arabes pour les soulever contre les Turcs. Il s’agissait d’une rupture avec des promesses antérieures d’indépendance faites au porte-parole de la nation arabe, le chérif Hussein, gardien des lieux saints de La Mecque et de Médine.
Les accords Sykes-Picot, relevant de la diplomatie secrète, n’ont pas de valeur légale. Ils devront en fait être entérinés et légalisés par un mandat en bonne et due forme de la Société des Nations à la conférence de San Remo en avril 1920. Le partage décidé ne sera jamais appliqué intégralement ; il y aura notamment la cession en 1919 de Mossoul à l’Angleterre par Clemenceau et la naissance de la Turquie moderne, ainsi que la création de l’Arabie saoudite actuelle en plusieurs étapes au cours des années 1920 et 1930.
Le tracé des frontières actuelles au Moyen-Orient ne découle pas seulement des accords Sykes-Picot, mais aussi d’une série de tractations entre les réunions à Versailles de décembre 1918 et la conférence de San Remo en avril 1920, voire au-delà durant les années 1920, au cours des mandats français et britanniques.
L’accord franco-britannique doit faire face à une double opposition : l’insurrection nationale turque de Mustafa Kemal, le futur Atatürk, en Anatolie, en opposition au traité de Sèvres, et l’installation du pouvoir des Hachémites, s’appuyant sur les nationalismes arabes, en Mésopotamie (Irak actuel), en Syrie et en Transjordanie. En effet, en 1916, par cet accord, Britanniques et Français contrarient la naissance d’un État arabe unifié dans l’ensemble du Moyen-Orient et de la péninsule arabique, promis par la Grande-Bretagne aux Arabes en 1915 en contrepartie d’une aide des troupes arabes contre l’Empire ottoman pendant la première guerre mondiale.
La révolte arabe de 1916 / 1918
La révolte arabe, appelée plus communément « grande révolte arabe », est une rébellion menée entre 1916 et 1918 à l’initiative du chérif de La Mecque, Hussein ben Ali. Le but est de participer à la libération de la péninsule Arabique, alors en grande partie occupée par l’Empire ottoman, et de créer un État arabe unifié qui irait d’Alep en Syrie à Aden au Yémen, inspiré du nationalisme arabe. Le 6 juin 1916, le chérif se soulève contre les Turcs. Les premiers succès surviennent très vite, avec la prise de La Mecque et le siège de Médine, jusqu’à l’entrée de l’armée britannique, avec l’aide des troupes arabes, dans Jérusalem le 9 décembre 1917. Le 30 octobre 1918, l’Empire ottoman signe l’armistice de Moudros qui prévoit l’évacuation de toutes les garnisons ottomanes restantes en Syrie et en Arabie.
En effet, au cours de la première guerre mondiale, les Britanniques cherchent le soutien arabe pour ouvrir un nouveau front au sud de l’Empire ottoman. Le Royaume-Uni signe, dès le 26 décembre 1915, avec Ibn Saoud, roi de Nejd, le traité de Darin, afin de s’assurer qu’il n’attaquera pas les protectorats britanniques du Koweït, du Qatar et des États de la Trêve (groupe d’émirats dans le golfe persique sous protectorat britannique, et qui devinrent en 1971 les Emirats arabes unis). Ibn Saoud ne prendra pas part à la guerre. Les Alliés poussent alors Hussein ben Ali, chérif de la Mecque, à se révolter contre les Ottomans. En échange, il reçoit la promesse de l’indépendance arabe sur les territoires ainsi libérés.
La révolte atteint ses objectifs mais les Britanniques, qui l’ont encouragée lorsqu’ils étaient en guerre contre l’Empire ottoman, trahissent les promesses faites aux Arabes une fois la victoire obtenue. L’État arabe unifié ne verra jamais le jour. La contribution des troupes arabes qui a favorisé la défaite de l’Empire ottoman n’est donc pas récompensée. Les Britanniques s’étaient engagés par ailleurs de manière contradictoire, vis-à-vis des Français, et vis-à-vis du mouvement sioniste. C’est ainsi qu’ils ont également signé avec les Français les accords Sykes-Picot leur donnant le contrôle de la Syrie et du Liban. Ils se sont également engagés par la déclaration Balfour, à créer un « foyer national juif » en Palestine, sans en définir précisément les contours, sur une partie du territoire du futur royaume arabe promis. N’ayant pas été entendu lors de la conférence de Versailles, qui ne retient pas l’idée d’un grand royaume arabe, Fayçal (fils du chérif Hussein) le proclame lui-même, dans Damas occupé par l’armée française. L’existence de ce royaume arabe est brève : il est créé en janvier 1920, mais l’armée française en juillet de la même année écrase à la bataille de Mayssaloun les forces arabes et met fin à cette entité nouvelle. Entretemps, la conférence de San Remo d’avril 1920 officialise le mandat français de Syrie.
Dans le même temps, Londres obtient un mandat britannique en Palestine en mettant en avant le principe du projet sioniste. Le traité de Sèvres, qui prolonge la conférence de San Remo, établit également le mandat britannique de Mésopotamie. Soucieux de conserver des soutiens dans la région, les Britanniques créent, dans la partie de leur mandat à l’est du Jourdain, un émirat de Transjordanie confié à l’émir Abdallah, un des fils d’Hussein (et donc frère de Fayçal). Ils mettent également Fayçal, en compensation de son éviction de Syrie par la France, sur le trône du royaume d’Irak (succédant au mandat de Mésopotamie). La dynastie hachémite conserve ainsi deux trônes, même quand elle est chassée du Hedjaz par Ibn Saoud en 1925. Ces dispositions sont officialisées dans le Livre blanc de 1922, également connu sous le nom de « Livre blanc de Churchill ».
La déclaration Balfour
La Déclaration Balfour du 2 novembre 1917 est une (courte, de 67 mots) lettre ouverte signée du secrétaire d’État britannique aux Affaires étrangères. Elle est adressée à Lord Rothschild, personnalité éminente de la communauté juive britannique et financier du mouvement sioniste. Le Royaume-Uni s’y déclare en faveur de l’établissement en Palestine d’un foyer national pour le peuple juif. Cette déclaration est considérée comme une des premières étapes dans la création de l’État d’Israël.
L’opposition des arabes n’est cependant pas immédiate. Mais assez rapidement, les nationalistes arabes perçoivent la déclaration Balfour comme étant en contradiction avec la promesse d’un grand État arabe indépendant que laissait entrevoir la correspondance McMahon-Hussein en 1915. Leur panarabisme se sent surtout floué par les accords Sykes-Picot conclus secrètement en 1916, prévoyant la mise sous tutelle des possessions turques au Moyen-Orient divisées en mandats séparés, ce que la conférence de San Remo (1920) institutionnalise.
Quant aux chefs religieux, ils annoncent dès la publication de la déclaration Balfour que « les musulmans du monde entier ne pourront jamais accepter que Jérusalem soit un jour aux mains des Juifs … Peu à peu une opposition s’organisera chez les musulmans et un jour on verra de nouvelles croisades mais musulmanes contre les Juifs ». Notons que les Anglais auront des réticences à mettre en application cette déclaration Balfour et freineront quelque peu la réalisation du foyer national juif.
Vers la chute finale : le traité de Sèvres 1920
Le traité de Sèvres consacre le démembrement suivi du partage et de la fin de l’Empire ottoman, après six siècles d’existence. Il est signé le 10 août 1920 entre les alliés vainqueurs et l’empire ottoman, suite à l’armistice de Moudros du 30 octobre 1918. L’empire ottoman est grosso modo réduit à l’Anatolie, en Asie. Il perd ses provinces arabes, ainsi que quelques territoires significatifs en Anatolie même, comme la région de Smyrne ou la Cilicie, étant réduit à environ 420 000 kms² (en comparaison des 1 780 000 kms² d’avant-guerre et aux 3 millions de la fin du XVIII° siècle).
A l’ouest, la Thrace orientale, hormis Constantinople / Istanbul et ses territoires avoisinants, était cédée à la Grèce. A l’est, l’indépendance d’une grande Arménie était reconnue, alors qu’une province autonome kurde doit être créée. Quant aux provinces orientales, elles passaient sous mandat de la Société des Nations, dans le prolongement des accords Sykes / Picot, en vue d’une indépendance ultérieure (la Syrie et le Liban à la France, la Mésopotamie, c’est-à-dire le futur Irak, et la Palestine au Royaume-Uni). Les détroits du Bosphore et des Dardanelles étaient par ailleurs démilitarisés.
En définitive, le nouvel Empire ottoman devient un petit territoire composé en grande partie des steppes de l’Anatolie centrale. Ses possibilités de développement sont en outre limitées en raison d’un système de « garanties » qui mettent les finances du pays sous la tutelle de commissions étrangères. Toutes les ressources du pays doivent être en effet affectées en priorité aux frais d’occupation et au remboursement des indemnités dues aux Alliés. L’armée doit être intégralement dissoute pour être remplacée par une force de gendarmerie. Un article du traité prévoit le rétablissement des Capitulations. Enfin, la police, le système fiscal, les douanes, les eaux et forêts, les écoles privées et publiques doivent être soumis au contrôle permanent des Alliés.
Refuser Sèvres : le sursaut de la guerre d’indépendance turque 1919 / 1922
Le traité de Sèvres ne sera jamais ratifié par l’ensemble de ses signataires. Il va au contraire provoquer en Turquie un sursaut nationaliste autour de Mustafa Kemal. Celui-ci avait commencé à organiser un pouvoir nationaliste parallèle en 1919, qui s’opposait à celui du sultan ottoman, pas encore déchu, et qui subsistait tant bien que mal. C’est l’origine de la guerre d’indépendance turque, ou guerre de libération. Il s’agit du nom donné aux conflits qui se déroulèrent en Turquie du 19 mai 1919 au 11 octobre 1922, date de la signature d’un nouvel armistice. Mais il faut y inclure également les conflits contre les troupes grecques et arméniennes, contre les autonomistes kurdes et contre les troupes d’occupation italiennes et britanniques.
En revanche, l’empire ottoman bénéficiait de l’appui de la France (qui, en mars 1921, signait un accord avec le gouvernement kémaliste, puis un traité de paix en octobre de la même année, et lui vendit des armes) et de la Russie soviétique (qui lui fournit également des armes et lui céda, au traité de Kars d’octobre 1921, le territoire arménien occupé un an plus tôt par les troupes kémalistes). Précisons tout de même que les Français avaient été auparavant chassés d’Anatolie par les kémalistes à l’issue de la campagne de Cilicie que le traité de Sèvres leur avait octroyée.
Par leurs victoires face aux Grecs et aux Arméniens, les armées kémalistes contraignirent les Alliés à une révision du traité de Sèvres devenu inapplicable. Sa renégociation s’effectua dans le cadre d’une conférence internationale qui aboutit au traité de Lausanne de juillet 1923. Il se substituait aux principales clauses du traité de Sèvres pour refléter le nouveau rapport de forces ainsi créé.
Refuser Sèvres : le sursaut du traité de Lausanne
Le traité de Lausanne, signé le 24 juillet 1923, remplace donc le traité de Sèvres du 10 août 1920. C’est le dernier traité résultant de la Première Guerre mondiale. Il précise les frontières de la Turquie issue de l’Empire ottoman. Après des mois de tractations, il est signé entre, d’une part la Turquie, et d’autre part la France, le royaume d’Italie, le Royaume-Uni, l’empire du Japon en tant que puissances victorieuses, mais aussi le royaume de Grèce, le royaume de Roumanie, le royaume des Serbes, Croates et Slovènes (c’est-à-dire la Yougoslavie) et le royaume de Bulgarie qui seront impactés pour les échanges significatifs de populations en résultant.
Le traité de Lausanne reconnaît en premier lieu la légitimité du régime de Mustapha Kemal installé à Ankara. En échange les Alliés obtiennent la reconnaissance par la nouvelle république turque des pertes territoriales de l’Empire ottoman à Chypre (1878), dans le Dodécanèse (1911), en Syrie, Palestine, Jordanie, Irak et Arabie (1918), dont celles prévues par le traité de Sèvres. Mais en contrepartie, les Alliés renoncent à demander l’indépendance de l’Arménie et l’autonomie du Kurdistan, initialement prévues dans le traité de Sèvres. Au sandjak d’Alexandrette près (réglé entre la France et la Turquie en 1938), les frontières de la Turquie actuelle sont reconnues : la république turque assure ainsi, et fait reconnaître, sa souveraineté sur l’ensemble de l’Anatolie (occidentale et orientale) et sur la Thrace orientale.
La zone démilitarisée mise en place à Sèvres autour des détroits des Dardanelles et du Bosphore est maintenue. Les détroits restent ouverts, sans restriction ni contrôle turcs, au passage aérien et à la navigation maritime internationale. En échange, le contrôle des Alliés sur les finances et les forces armées turques est aboli, ainsi que le régime des « Capitulations ». De la sorte, la Turquie retrouve sa pleine souveraineté avec tous les attributs afférents. Elle évite le risque de colonisation européenne. Par le traité de Kars, conclu en octobre 1921 avec la Russie soviétique, la Turquie avait pu récupérer le territoire de Kars perdu en 1878 par les sultans ottomans. Elle put également bénéficier de l’armement soviétique dans sa lutte contre les Arméniens, les Grecs et la Triple-Entente.
Echanges de populations ou épuration ethnique ?
Le traité de Lausanne est désastreux pour la Grèce. Elle perd tous ses acquis. Elle s’était émancipée de la protection obligatoire que les grandes puissances lui avaient imposée (ou garantie selon les points de vue) à la suite de la guerre d’indépendance grecque des années 1820. Après avoir été à deux doigts de réaliser sa « Grande Idée » (dont la visée était d’unir tous les Grecs dans un seul État-nation qui aurait pour capitale Constantinople), elle doit y renoncer définitivement. Elle doit accueillir un million et demi de réfugiés grecs d’Asie mineure. En outre, 300 000 autres, notamment dans la région du Pont et en Cilicie, doivent se convertir à l’islam et passer à la langue turque pour survivre. C’est ce que les Grecs appellent la « Grande Catastrophe ».
Il est vrai que les kémalistes invitaient en Turquie les minorités turques des pays voisins, souhaitant les échanger contre les minorités chrétiennes vivant en Turquie et dont ils ne voulaient plus. Le traité de Lausanne institua donc ces échanges de populations obligatoires entre la Grèce et la Turquie : 1,6 million de Grecs ottomans contre 385 000 musulmans de Grèce. Ces échanges forcés ont débuté « baïonnette dans le dos », bien avant la signature du traité en juillet 1923. Près d’un demi-million de Grecs de Turquie sont morts (pour la plupart dans les camps ou en route) et 400 000 musulmans, en majorité des Turcs, ont quitté, eux, la Grèce pour la Turquie. L’échange de population était strictement basé sur l’appartenance religieuse. Les exceptions du traité permirent à près de 300 000 Grecs de rester en Turquie à Istanbul et dans les îles concernées, tandis qu’en Thrace occidentale environ 230 000 musulmans purent rester en Grèce. Mais, dans les décennies suivantes, les discriminations et persécutions poussèrent la plupart de ces exemptés à s’exiler d’eux-mêmes, de sorte qu’au XXI° siècle il reste 140 000 musulmans en Grèce et seulement quelques milliers de Grecs en Turquie.
Ces transferts de populations obligatoires avaient déjà commencé avec les génocides arménien et grec pontique. Ils visaient à rendre irréversible ce qui fut appelé « nettoyage ethnique » par l’historiographie grecque et « stabilisation de l’homogénéité ethno-religieuse » par l’historiographie turque. Certains euphémismes pourraient être savoureux s’ils n’étaient dramatiques.
La Turquie, déclin ou sursaut ? La fin d’un monde
Les conséquences de la guerre d’Indépendance, dans le prolongement du premier conflit mondial, sont significatives. L’Empire ottoman cesse formellement d’exister. Il est remplacé par la République de Turquie dirigée par Mustafa Kemal Atatürk. En effet, en 1923, c’est la chute du sultanat. L’année suivante, en 1924, le califat est aboli. Ce changement radical de régime, largement préparé par le gouvernement des Jeunes-Turcs des années 1908 et suivantes, est une étape déterminante du processus révolutionnaire connu dans les années qui suivront sous le terme de kémalisme.
Ces événements peuvent être interprétés de manières divergentes. Certains les perçoivent comme la poursuite d’un irrésistible déclin ponctué par la chute finale du sultanat et du califat. D’autres, comme les kémalistes, au contraire ressentent les faits comme l’invitation à une régénération salvatrice. Encore aujourd’hui, la chose n’est pas définitivement tranchée. Il prédomine une certaine nostalgie de l’idée impériale pour le président Erdogan, volontiers présenté par ses adversaires (et même ses soutiens) comme un aspirant sultan.
Les enseignements de la fin du monde, des questions toujours actuelles
Les accords Sykes-Picot et plus largement tout le processus de dépeçage de l’Empire ottoman demeurent au XXIe siècle un facteur de déstabilisation du Moyen-Orient. En effet, dans les pays arabes, les accords Sykes-Picot sont associés à l’idée d’un destin imposé arbitrairement aux peuples de la région par des puissances européennes (aujourd’hui plus largement occidentales). Ils sont dénoncés, dans les pays arabes, comme un héritage des anciennes puissances coloniales de l’époque, le Royaume-Uni et la France en tête.
La critique de la « diplomatie secrète » de la France et de la Grande-Bretagne est également un thème diffusé sur le moment par le président américain Woodrow Wilson. Le pouvoir révolutionnaire bolchevique fait également partie des détracteurs des accords Sykes-Picot.
Cependant, il existe un élément de stabilité qu’il est nécessaire de noter. Les frontières sont restées telles qu’elles furent tracées en 1919, à l’exception du sandjak d’Alexandrette, annexé par la Turquie en 1939.
Les Balkans restent toujours explosifs. Leur qualificatif de poudrière n’est pas usurpé, même s’il semble difficile de considérer qu’ils puissent être à l’origine d’une nouvelle déflagration d’ampleur, même inférieure à celle du premier conflit mondial qui débuta à Sarajevo. Les tensions avaient été cependant mises quelque peu en sommeil au moment du monde bipolaire de la guerre froide dans la deuxième moitié du XX° siècle. Le couvercle a en partie sauté avec la fin de la guerre froide et la dislocation du bloc soviétique.
L’antagonisme entre la Grèce et la Turquie est loin de s’être totalement éteint. Il est susceptible de se réveiller en certaines occasions. La situation conflictuelle de Chypre en est un exemple.
La déclaration Balfour pose des bases, pas parmi les plus saines et les plus claires, de la future question israélo-palestinienne. La rivalité entre les Séoud et les Hachémites découle des double-jeux des puissances européennes, et principalement de l’anglaise. Il s’agira d’un fil conducteur tenace de l’histoire tourmentée du Moyen-Orient.
De manière plus générale, ces événements accroissent le ressentiment éprouvé par le monde arabe, et au-delà du monde musulman, contre la duplicité des Européens. Il sera de nature à alimenter les revendications contemporaines du « Sud global » à l’égard de l’Occident que nous percevons à l’occasion de certains des conflits actuels.
Francis DASPE
Décembre 2023
Terminer un conflit militaire : la première guerre mondiale
La guerre en Ukraine et le conflit israélo-palestinien posent la question du défi de la construction de la paix. Faire la guerre est certes un défi de taille, mais savoir la terminer et parvenir à la paix en représentent un autre sans aucun doute de taille bien supérieure. La manière dont s’est terminée la première guerre mondiale révèle des enseignements particulièrement instructifs. Et permet également de rétablir quelques réalités historiques souvent bafouées.
Images d’Epinal et réalités factuelles
Les images d’Epinal véhiculées par la fin du premier conflit mondial sont bien connues. La première renvoie à la signature de l’armistice le 11 novembre 1918 en forêt de Rethondes, près de Compiègne. Elle se prolonge avec le traité de Versailles en juin 1919. De ces deux événements bien identifiés dans la mémoire collective, découlent un ressenti côté allemand s’incarnant dans deux formules passées à la postérité. L’armistice serait un « coup de poignard dans le dos » donné à l’armée allemande qui n’était pas vaincue et dont le territoire n’a pas été envahi. L’Allemagne n’a pas perdu la guerre, mais a été trahie par l’arrière. L’armistice, qui signifie arrêt des combats, ne signifiait pas la défaite et la capitulation de l’armée allemande. En conséquence, l’Allemagne espérait pouvoir négocier une paix honorable. C’est dire à quel point le traité de Versailles, aux clauses extrêmement lourdes, fut perçu comme une humiliation et un « diktat ». Coup de poignard dans le dos et diktat, tels furent les éléments que la propagande nationaliste, portée à son paroxysme par les nazis obnubilés par une quête de revanche, reprit à l’envi.
C’est pourtant en grande partie faux. La réalité est bien plus complexe que ce récit instrumentalisé a posteriori laisse à dire. Le rétablissement, dans sa rigueur et son exactitude, du factuel s’avère riche d’enseignements. Pour cela, il convient de rappeler en préalable quelques réalités fondamentales. La guerre devait être courte. C’était la conviction partagée par chacun des deux camps, ce qui explique les départs au front la « fleur au fusil », que les propagandes amplifièrent notoirement. La stratégie de guerre de mouvement devait permettre de parvenir à la victoire rapide. A la fin de l’année 1914, à la suite de l’échec successif des deux offensives (plan Schlieffen côté allemand, puis contre-offensive française de la Marne) et de la course à la mer, une évidence s’impose aux belligérants. Le conflit sera long, dur et meurtrier. Il s’agira d’une guerre de position, d’usure, de tranchées. En outre, les combats se dérouleront presque exclusivement sur le territoire français. Le territoire allemand ne sera pas réellement affecté, ni envahi même au moment de l’effondrement de l’Empire et de la signature de l’armistice. D’où le sentiment, sans doute davantage véhiculé de manière opportune que vraiment ressenti en fin de compte, que l’armée allemande n’avait pas été vaincue.
L’enthousiasme des débuts de la guerre était retombé au bout d’une année de combats. L’enfer des tranchées devint rapidement le quotidien de ce conflit meurtrier et absurde, ce que vient confirmer les mutineries qui culminèrent en 1917. C’est cela qui explique pour partie les quelques tentatives de paix au cours du conflit. L’idée d’une paix blanche a émergé, c’est-à-dire sans annexions, même si cela ne se traduisit pas dans les faits concrètement.
L’Allemagne lâchée et cernée
En réalité, l’Allemagne est poussée à demander l’arrêt des hostilités. Elle est même la dernière à vouloir résister. Elle est en effet progressivement lâchée par ses alliés à partir de l’automne 1918. Des armistices alors signés par les alliés de l’Allemagne mettent fin à la première guerre mondiale. Sur les fronts des Balkans, du Proche-Orient et d’Italie, la Bulgarie, l’Empire ottoman et l’Autriche-Hongrie ne peuvent soutenir l’effort de guerre et se retrouvent dans l’incapacité de poursuivre les hostilités. Ils laissent l’Allemagne complètement isolée, et contribuent à sa capitulation le 11 novembre 1918.
C’est d’abord la Bulgarie qui demande l’armistice le 29 septembre. Un mois plus tard, l’empire ottoman signe à son tour l’armistice de Moudros le 30 octobre. Après la défaite de Vittorio Veneto face aux troupes italiennes, l’empire austro-hongrois est contraint de signer l’armistice le 4 novembre à Villa Giusti. La défection de l’Autriche-Hongrie est un coup dur pour les Allemands qui perdent ainsi leur principal allié du bloc germanique constitué un demi-siècle plus tôt sous les auspices de Bismarck.
A la suite de la grande offensive lancée le 8 août par les Alliés commandés par le français Foch, les troupes allemandes se retrouvent dans une situation délicate. Pour la première fois, des milliers de soldats allemands se rendent sans combat. En Allemagne, l’empereur Guillaume II refuse d’abdiquer, ce qui entraîne des manifestations en faveur de la paix. Le 3 novembre, des mutineries éclatent à Kiel : les marins refusent de livrer une bataille « pour l’honneur ». La vague révolutionnaire allemande gagne tout l’Empire. Le 9 novembre, le kaiser Guillaume II est contraint d’abdiquer. L’état-major demande alors que soit signé l’armistice. Le gouvernement de la nouvelle République allemande le signe dans la forêt de Compiègne à côté de Rethondes le 11 novembre 1918, dans le fameux wagon qui sera réutilisé plus de vingt ans plus tard à la demande expresse d’Adolf Hitler. Les Allemands, qui n’ont pas connu la guerre sur leur territoire et ont campé pendant quatre ans en terre ennemie, imaginent mal qu’ils sont vraiment vaincus. Car, en comparaison des dévastations causées en territoire ennemi, principalement français, la puissance allemande n’est pas véritablement affectée en profondeur. La puissance industrielle (élément majeur de la force d’une nation) de l’Allemagne est en partie intacte.
Place à la propagande : sauver la face
C’est ainsi que va naître la thèse du coup de poignard dans le dos, ensuite relayée et confortée par celle du diktat du traité de Versailles. En effet, pour sauver les apparences, l’état-major allemand fait circuler cette thèse de la trahison de l’arrière, qui sera de surcroît imputée au nouveau régime de la République de Weimar. Hitler en fera son miel quelques années plus tard. A sa suite, les propagandistes nazis pourront déclarer que l’armée allemande avait protégé le pays et ne s’était pas rendue, la défaite incombant uniquement aux civils. Et aux tenants d’un régime plus démocratique, la République de Weimar. Et ce d’autant plus que des dirigeants allemands d’origine juive, comme Matthias Erzberger ou Walter Rathenau, furent assimilées aux discussions et à l’acceptation des textes honnis. Les deux finirent d’ailleurs assassinés par l’extrême droite.
Les (nombreux) traités de paix à la suite de la première guerre mondiale ne sauraient se limiter à celui de Versailles, certes le plus connu par notre historiographie européano-centrée (il serait plus juste de dire occidentalo-centrée). Ils dépassent très largement le sort particulier de l’Allemagne. Ils provoquent en réalité la chute immédiate de trois gigantesques empires (allemand, austro-hongrois, ottoman, sans même compter le russe dont l’effondrement précéda leur chute) et la recomposition politique aussi bien de l’Europe centrale que du Proche-Orient au profit des vainqueurs.
Agathe RAIENO
Décembre 2023
Le vertige des chiffres… La Corée du Sud illibérale ?
Chiffres extraits d’un article paru dans Le Monde Diplomatique n° 832 de Juillet 2023.
La Corée du Sud est la 12° puissance économique mondiale. Elle fait partie des NPI (nouveaux pays industrialisés) d’Asie de la première génération (c’est-à-dire des quatre dragons avec Singapour, Taïwan, Hong-Kong).
Les Sud-Coréens travaillent en moyenne 1910 heures par an. La moyenne pour les pays de l’OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques) s’établit à 1716 heures (1490 en France, 1349 en Allemagne).
Cependant, ce chiffre minore la réalité des horaires réellement pratiqués. En effet, en Corée du Sud, un mécanisme permet aux entreprises de verser un « forfait heures supplémentaires » indépendant du temps d etravail effectivement réalisé.
60% des salariés ne prennent pas tous leurs congés. Le plus souvent par peur de perdre leur emploi.
Le temps de travail par semaine est de 52 heures. Un projet vise à l’augmenter à 69 heures. Ce projet prévoit aussi de pouvoir travailler jusqu’à 120 heures par semaine, quitte à se reposer ensuite les semaines suivantes. 120 heures par semaine, cela équivaut en fait à 7 heures de travail par jour pour une semaine de 7 jours de travail.
Les manifestations ne sont tolérées que les décibels produits par la sonorisation ne dépassent pas 95 décibels (soit le ronflement d’un sèche-cheveux). Sans quoi, les contrevenants s’exposent à des peines de prison pouvant aller jusqu’à 6 mois.
Les treize présidents du syndicat KCTU (confédération coréenne des syndicats) créé en 1995 ont été emprisonnés.
Plus de la moitié des salariés sud-coréens sont dit « irréguliers ». C’est-à-dire les précaires, les pseudos auto-entrepreneurs, les sans-papiers, salariés soumis à des dispositifs de sous-traitance en cascade les privant de des droits et de la protection sociale accordés par les grands groupes.
Pendant la période de pandémie, les salaires du groupe Daewo ont été amputés de 30%. Les salariés qui demandaient le rattrapage ont obtenu une augmentation de 4,5% de leurs rémunérations.
L’entreprise à cependant porté plainte contre 5 dirigeants syndicaux. Elle exige qu’ils lui remboursent (de leur propre poche) les pertes liées aux divers retards de production. Soit 33 millions d’euros.
En Corée du Sud, l’âge officiel de départ à la retraite est de 60 ans. Mais il faut attendre 65 ans pour percevoir la pension versée par l’Etat. A taux plein, la pension équivaut à environ 30% des derniers salaires perçus. La plupart des sud-coréens doivent donc travailler après l’âge légal de d »part à la retraite dans des emplois précaires et mal payés.
Un dispositif gouvernemental a en outre aggravé la situation depuis une dizaine d’années. Les entreprises ont été autorisées à réduire les rémunérations des travailleurs les plus âgés, à partir de 56 ans le plus souvent, au prétexte de favoriser l’emploi des jeunes. C’est ainsi que les dernières années de travail, celles qui sont prises en compte pour le calcul des pensions de retraites, se caractérisent par une baisse significative des salaires.
Les personnes âgées de plus de 65 ans représentent plus de la moitié des pauvres.
Les primes de licenciement débutent à partir du douzième mois de travail. Mais la plupart des contrats de travail sont de 11 ans. A chaque renouvellement, le compte reprend à zéro : les salariés n’acquièrent donc aucun droit.
La Corée du Sud affiche le plus faible taux de natalité du monde : 0,78 enfant par femme. Une étude de 2021 indiquait qu’un séoulite (habitant de Séoul) sur 3 n’avait pas fait l’amour depuis plus d’un an.
Entre 1948 et 1949, la répression sur l’île Cheju d’un soulèvement populaire, que les autorités américaines et le dictateur Rhee Syngman accusaient d’être communiste, a fait plus de 30 000 victimes. Soit environ 10% de la population de l’île.
Dans les années 1980, plus de 40 000 « délinquants », pour beaucoup coupables d’être communistes, seront internés dans le réseau de camps de rééducation mis en place par la dictature sud-coréenne.
Thierry DONGUAT
04 / 10 / 2023
ASSOCIATION POUR LA GAUCHE REPUBLICAINE ET SOCIALE– Prométhée
Chez Francis Daspe 19 avenue Carsalade du Pont, porte 2, 66100 PERPIGNAN
Site internet : www.agaureps.org
Courriel : agaureps@orange.fr
FICHE D’ADHESION ANNEE 2024
NOM :
Prénom :
Date et lieu de naissance :
Adresse :
Numéro(s) téléphone(s) :
Courriel :
Profession :
Le montant de l’adhésion annuelle est fixé à 10 Euros. Le règlement peut se faire en espèces ou par chèque à l’ordre de l’AGAUREPS-Prométhée. Envoyer tout courrier à l’adresse indiquée en en-tête.